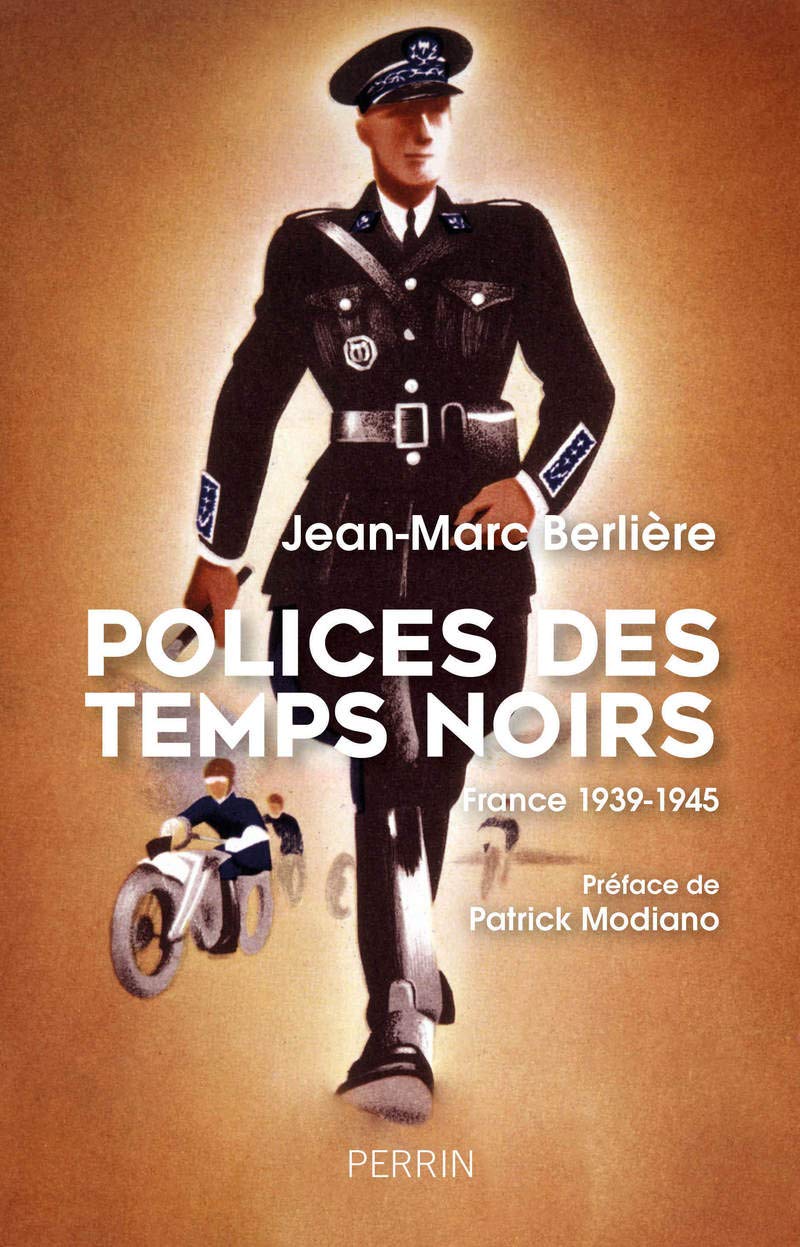
22 Jan La police dans la tourmente de l’Occupation : un dictionnaire de la répression
Jean-Marc Berlière, Police des temps noirs : France, 1939-1945 (Perrin, 2018, 1 392 pages, 35 euros)
Pionnier de l’histoire de la police au sein du monde universitaire, Jean-Marc Berlière livre ici une somme très organisée et étayée sur les polices en France entre 1939 et 1944. « Les polices », au pluriel, car il ne s’agit en effet pas d’une histoire de la police au sens de la seule police nationale mais bien d’un travail de synthèse minutieux qui porte sur l’ensemble des forces françaises et allemandes impliquées dans le maintien de l’ordre et la répression dans le pays pendant cette période. Il s’agit donc évidemment d’étudier l’action des administrations mais aussi des multiples officines, services d’ordre de formations collaborationnistes et « Gestapos françaises » qui se sont arrogé des pouvoirs de police avec la bénédiction de l’occupant allemand.
Ce champ extrêmement vaste a conduit l’auteur à faire le choix d’une présentation par notices thématiques successives dans l’ordre alphabétique et non d’un déroulé chronologique, qui aurait pu être difficilement intelligible. On a donc affaire à une sorte de dictionnaire de la répression dont la richesse n’a d’égale que la rigueur. Comme le souligne la préface de Patrick Modiano, aborder l’histoire de la fonction policière, c’est aussi en miroir se confronter à la société française dans son ensemble, à ses contradictions et à la complexité de ces quatre années noires.
On évoquera essentiellement ici les éléments qui concernent la police et la gendarmerie. Toutefois, il faut donc garder à l’esprit la prolifération des services qui concourent à la répression et les tensions souvent vives entre services officiels, polices spécialisées (police aux questions juives…) créées par Vichy, miliciens et groupes exaltés partisans de la collaboration à outrance avec les nazis, qui mettaient en cause la tiédeur des premiers.
Il s’agit d’abord d’examiner la façon dont les policiers de 1940, formés par la IIIe République, ont appréhendé leur nouveau rôle sous un régime autoritaire. Vichy s’est empressé d’écarter les responsables policiers les plus « compromis » avant-guerre dans la lutte contre les ligues et les factieux d’extrême droite pour façonner un outil policier au service de l’idéologie pétainiste. La culture de la discipline et de l’obéissance inculquée aux fonctionnaires a beaucoup joué aussi dans un premier temps pour anesthésier des policiers qui ont globalement suivi les ordres jusque tard dans la guerre.
Ce d’autant qu’une partie de la répression des « menées antinationales » s’effectuait encore dans le cadre de la législation républicaine anticommuniste prise en 1939-1940 après le pacte germano-soviétique, soutenu par la direction moscoutaire du PCF d’alors. Certaines ruptures témoignent tout de même du caractère exceptionnel de la période, comme le rôle opérationnel donné aux Renseignements généraux et notamment aux Brigades spéciales de la préfecture de police de Paris. La République avait au contraire bâti un service de police politique cantonné à l’observation, les RG n’ayant pas vocation initialement à effectuer des interpellations.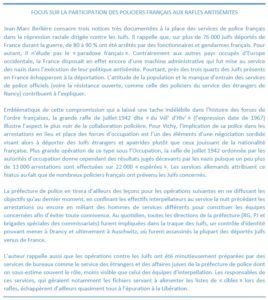
Jean-Marc Berlière replace aussi la grande réforme lancée en 1941 par Vichy, l’étatisation des polices municipales, dans son contexte. Les polices des grandes villes se voyaient déjà progressivement étatisées depuis le début du siècle dans un souci d’efficacité et d’impartialité ; l’Occupation aura finalement conduit à la généralisation de cette mesure pour les villes de plus de 10 000 habitants. Il s’agissait pour le régime de disposer d’un outil fiable piloté de manière centralisée pour appliquer sa politique répressive. C’est donc de cette époque que datent la police nationale, dont le caractère étatique ne sera pas remis en cause à la Libération, mais aussi ses structures. L’organisation en grandes directions chargées respectivement de la Sûreté nationale (police judiciaire), des Renseignements généraux, de la sécurité publique et du maintien de l’ordre perdure d’une certaine manière aujourd’hui encore sous des intitulés différents. De la même façon, les Groupes mobiles de réserve, créés par Vichy pour disposer d’un corps civil en charge du maintien de l’ordre, sont les ancêtres des CRS, qui reprendront leur personnel après épuration à la Libération. On peut penser aussi à la création des écoles de police pour les gardiens de la paix et de l’École nationale de police pour les commissaires, installée « provisoirement » à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or… où se trouve toujours aujourd’hui l’ENSP.
Sur le fond, Vichy se prête à un jeu de dupes qui consiste finalement à faire assurer, sous prétexte de maintien de la souveraineté française (cf. entre autres les accords Bousquet-Oberg de 1942), le maintien de l’ordre en France par la police, la gendarmerie et les forces supplétives pour le compte de l’occupant. Les nazis économisent ainsi des forces militaires sans pour autant céder de véritable pouvoir aux services français, auxquels ils refusent d’ailleurs régulièrement des suppléments d’armement de crainte que la police ne finisse par se retourner contre eux. Crainte non dénuée de fondement puisque c’est ce qui arrivera en août 1944 à Paris.
Les années de l’Occupation et le rôle que les gouvernements vichystes ont fait jouer aux forces de l’ordre ont évidemment durablement imprimé leur marque et généré, surtout dans des régions de maquis, une défiance dans les relations avec la population qui mettra du temps à s’estomper. Pour autant, l’auteur montre qu’une marge de manœuvre subsistait généralement pour les personnels engagés dans les missions répressives contre les Juifs ou les résistants et que les réactions au sein de la police sont loin d’être univoques. Celles-ci vont en fait de l’implication enthousiaste dans ces nouvelles missions, avec des bénéfices directs en termes de carrière pour les intéressés, à l’engagement dans la Résistance en passant par la passivité, qui fut le refuge de beaucoup.
Cet ouvrage est l’occasion de rappeler que, contrairement à une idée reçue, l’épuration de la police et notamment de son cadre hiérarchique de 1944 au début des années 1950 a été réelle, quoique d’une sévérité inversement proportionnelle au temps écoulé depuis la Libération lorsque les intéressés arrivaient devant les juges.
Il faut relever enfin l’effort de mémoire qui est fait depuis quelques années notamment par la police nationale et la préfecture de police, dont les archives s’ouvrent aux historiens. Cette volonté se concrétise notamment avec la visite du Mémorial des enfants juifs exterminés d’Izieu précédant la cérémonie de sortie de l’ENSP pour les commissaires et officiers, ou du mémorial de la Shoah pour l’ensemble des personnels affectés à la préfecture de police. D’autres institutions comme la gendarmerie semblent encore peiner à sortir d’une histoire « officielle » bâtie autour du seul récit des hauts faits des gendarmes résistants (par ailleurs bien réels, mais qui ne représentent qu’une partie de l’histoire).
Une bibliographie développée sur chaque sujet permet à ceux qui le souhaitent d’aller plus loin à propos des thématiques évoquées, qui sont également autant de pistes pour l’avenir de la recherche historique dans ce domaine. Si l’histoire de la police et de la gendarmerie nationales sous le régime de Vichy commence à être connue, celle de la justice, des douanes ou encore de l’administration pénitentiaire, par exemple, reste ainsi encore largement à écrire pour approfondir notre connaissance du fonctionnement de l’appareil répressif sous l’Occupation.

